Aline Hémond, anthropologue et maîtresse de conférences au département de sociologie de l’université Paris 8, vient de coordonner, avec deux autres chercheurs, l’ouvrage Formas de voto, prácticas de las asambleas y toma de decisiones. Un acercamiento comparativo [Formes du vote, pratiques des assemblées et prises de décision, une approche comparative]
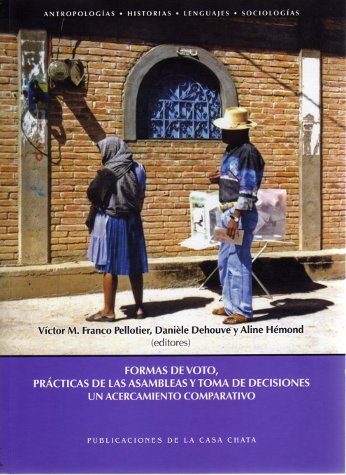
Dans tout type de société, l’exercice du pouvoir pose deux problèmes: Comment choisir les gouvernants ? Comment accorder une légitimité à leurs personnes et leurs actions ? Les réponses apportées dans l’histoire ont été diverses, des délibérations au vote, de la succession héréditaire au tirage au sort. Ce livre offre une approche pluridisciplinaire qui suit l’évolution historique à partir de l’Antiquité et à travers les continents; il s’appuie sur des études de cas analysés dans toute leur complexité. Le cadre général ainsi dessiné permet de mieux comprendre l’expansion du modèle de démocratie occidentale à partir de la chute du Mur de Berlin. Plusieurs études de cas concernent le Mexique au cours de la période de « transition démocratique » (1988-2000). Cette somme d’analyses représente une introduction indispensable aux thèmes électoraux. Il a requis la collaboration enthousiaste de 27 mexicains et étrangers, spécialistes d’histoire, de sociologie, d’anthropologie et de philosophie.
V. M. Franco Pellotier, D. Dehouve et A. Hémond (éds.) : Formas de voto, prácticas de las asambleas y toma de decisiones. Un acercamiento comparativo [Formes du vote, pratiques des assemblées et prises de décision, une approche comparative], Mexico, CIESAS, Publicaciones de la Casa Chata, 2012, 490 pages.
 In english
In english Coline Cardi, maîtresse de conférences au département de sociologie de l’université Paris 8 et co-directrice de l’ouvrage Penser la violence des femmes, qui vient d’être publié par les éditions La Découverte, était récemment
Coline Cardi, maîtresse de conférences au département de sociologie de l’université Paris 8 et co-directrice de l’ouvrage Penser la violence des femmes, qui vient d’être publié par les éditions La Découverte, était récemment 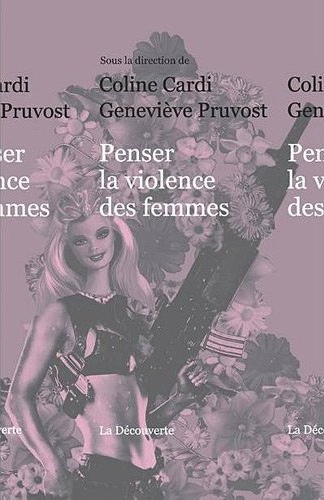 Tueuses, ogresses, sorcières, pédophiles, hystériques, criminelles, délinquantes, furies, terroristes, kamikazes, cheffes de gang, lécheuses de guillotine, soldates, policières, diablesses, révolutionnaires, harpies, émeutières, pétroleuses, viragos, guerrières, Amazones, boxeuses, génocidaires, maricides… Qu’y a-t-il de commun entre toutes ces figures ? Pour le comprendre, il importe d’exhumer, de dénaturaliser, d’historiciser et de politiser la violence des femmes. Telle est l’ambition de cet ouvrage qui propose une approche pluridisciplinaire sur un sujet trop longtemps ignoré des sciences sociales.
Tueuses, ogresses, sorcières, pédophiles, hystériques, criminelles, délinquantes, furies, terroristes, kamikazes, cheffes de gang, lécheuses de guillotine, soldates, policières, diablesses, révolutionnaires, harpies, émeutières, pétroleuses, viragos, guerrières, Amazones, boxeuses, génocidaires, maricides… Qu’y a-t-il de commun entre toutes ces figures ? Pour le comprendre, il importe d’exhumer, de dénaturaliser, d’historiciser et de politiser la violence des femmes. Telle est l’ambition de cet ouvrage qui propose une approche pluridisciplinaire sur un sujet trop longtemps ignoré des sciences sociales.

 RENCONTRE – DÉBAT à la librairie Le Genre Urbain
RENCONTRE – DÉBAT à la librairie Le Genre Urbain  Un mythe à détruire ? Origines et destin du centre universitaire expérimental de Vincennes
Un mythe à détruire ? Origines et destin du centre universitaire expérimental de Vincennes