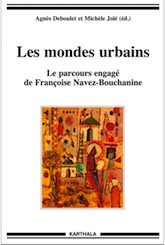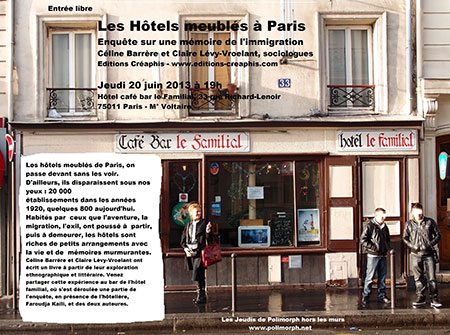Anaïs Leblon, maîtresse de conférences en anthropologie à l’université Paris 8, co-organise la journée d’étude : Patrimonialisations en migration qui se tiendra le 17 janvier 2014
INHA, salle Jullian, 2 rue Vivienne, 75002 Paris
17 janvier 2014
9h accueil
9h30
Introduction
9h40
Anna Perraudin (Post-doctorante. Université Aix-Marseille, CNRS, Lames et Telemme – Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence. Associée à l’Urmis (UMR 205))
Renverser le stigmate. Réappropriation de cultures minoritaires en migration : le cas des Indiens andins en Espagne
10h30
Christian Rinaudo (Maître de Conférences HDR, Université Nice Sophia Antipolis
Directeur adjoint de l’URMIS (UMR 205))
Son jarocho en migration (Mexique—Etats-Unis): acteurs, circuits et enjeux de la patrimonialisation d’une pratique en diaspora
11h20
Pause café
11h40
Jessica Roda (Postdoctorante à la Chaire de Recherche du Canada en Patrimoine Urbain (UQAM))
Le patrimoine musical judéo-espagnol, un territoire virtuel fédérateur pour la communauté
12h30 Pause déjeuner
14h30
Julie Garnier, Maître de Conférences en sociologie, Université de Tours, UMR CNRS 7324,
CITERES et Anais Leblon, Maître de Conférences en anthropologie, Université de Paris 8, membre de l’équipe AUS, UMR CNRS 7218, Lavue
Quand la patrimonialisation des mémoires et/ou des cultures transnationales ne prend pas ! Retour sur les relations entre acteurs de la société
civile et institutions
15h20
Michel Rautenberg (Professeur de sociologie, Université Jean Monnet, St Etienne, Centre Max Weber)
Traces du passé migratoire, effacement et activations mémorielles dans deux villes industrielles, St Etienne (France) et Cardiff (Pays de Galles)
16h10
Sébastien Galliot (Post-doctorant du labex CAP (Création, Arts et Patrimoines), Paris 1 Panthéon-Sorbonne/LAHIC/IIAC)
Quand les politiques patrimoniales de l’Unesco se heurtent à l’entrepreneuriat familial: les îles Samoa et le tatouage.
17h00
Conclusion et clôture
Discutants au cours de cette journée : Maria Gravari-Barbas (IREST/Paris 1 Panthéon Sorbonne) et Cyril Isnart (University of Évora, Portugal).
Cette journée est soutenue par le Labex CAP (Création, Arts et Patrimoines), l’EIREST (Équipe Interdisciplinaire de Recherches sur le Tourisme) et Respatrimoni (Réseau des chercheurs en patrimonialisations)
Organisatrices: Aurélie Condevaux (ATER Université de Poitiers, EIREST/MIGRINTER), Anaïs Leblon (MCF Université Paris 8, Aus-Lavue/CEMAF).
Contacts : aurelie.condevaux-a[a]hotmail.fr; anaisleblon[a]gmail.com
 In english
In english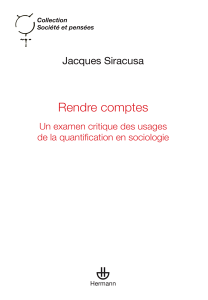 Comme on expose un patrimoine à valoriser, il s’agit de présenter un ensemble de controverses ; puis d’en tirer quelques conséquences. Les controverses sont celles suscitées par l’usage des statistiques en sociologie, que celles-ci soient administratives ou issues de sondages par questionnaires. L’auteur rapporte le point de vue des « pro » comme celui des « anti » statistiques et montre que nombre de difficultés, débattues depuis près d’un siècle, conduisent à poser ces questions : comment les données ou les résultats quantifiés sont-ils interprétés dans la discipline ? Qu’est-ce qui justifierait ces interprétations ou rendrait intelligibles les conclusions étayées du sociologue ? La réponse de l’auteur, sous forme d’éclaircissement, est une contribution à l’étude de l’argumentation en sociologie et un examen de la délicate conciliation des cultures littéraire et mathématique.
Comme on expose un patrimoine à valoriser, il s’agit de présenter un ensemble de controverses ; puis d’en tirer quelques conséquences. Les controverses sont celles suscitées par l’usage des statistiques en sociologie, que celles-ci soient administratives ou issues de sondages par questionnaires. L’auteur rapporte le point de vue des « pro » comme celui des « anti » statistiques et montre que nombre de difficultés, débattues depuis près d’un siècle, conduisent à poser ces questions : comment les données ou les résultats quantifiés sont-ils interprétés dans la discipline ? Qu’est-ce qui justifierait ces interprétations ou rendrait intelligibles les conclusions étayées du sociologue ? La réponse de l’auteur, sous forme d’éclaircissement, est une contribution à l’étude de l’argumentation en sociologie et un examen de la délicate conciliation des cultures littéraire et mathématique.


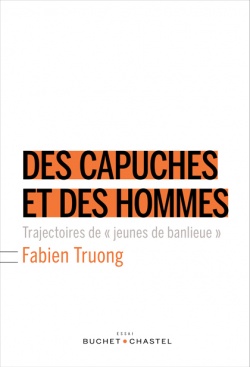 Des capuches et des hommes
Des capuches et des hommes